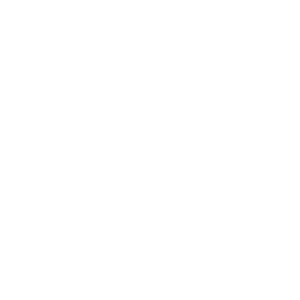GALERIE PHOTOS : Pourquoi les célébrations du 15 mars ont-elles été opprimées dans la Hongrie communiste ?
La commémoration de la La révolution civique hongroise et la guerre d'indépendance de 1848/1849 ont toujours été présentes dans l'histoire de notre pays d'une manière ou d'une autre. Cependant, lorsque la dictature communiste a pris le pouvoir en 1945 après l'occupation soviétique de la Hongrie, les célébrations autrefois nationales du 15 mars ont été strictement désapprouvées par le régime et ceux qui osaient encore organiser des rassemblements secrets pour se souvenir de nos héros de 1848 s'exposaient à de graves conséquences s'ils étaient pris par les autorités. .
Idéologies anti-régime
Bien qu'en 1948, le centenaire de la guerre d'indépendance hongroise soit encore commémoré par des événements de masse nationaux organisés de manière centralisée, son message avait déjà été modifié pour refléter l'idéologie officielle de l'époque. Éclipsant les actes héroïques des principaux dirigeants de la révolution, Kossuth, Petőfi et Táncsics, le secrétaire général du Parti communiste hongrois Mátyás Rákosi a été placé comme une figure centrale des célébrations du 15 mars, comme "l'homme qui a atteint les objectifs de la révolution" .
Cependant, dans les années suivantes, les commémorations ont commencé à être bloquées de force et finalement supprimées de la liste des fêtes nationales par les autorités en 1951 en tant qu'ordre officiel. La plupart des objectifs de 1848, de la liberté de la presse au rapatriement des soldats étrangers en passant par l'indépendance nationale et la libération des prisonniers politiques, étaient désagréables pour un pouvoir politique qui bénéficiait du soutien de l'occupation soviétique.
Lisez aussi : Que fêtent les Hongrois le 15 mars ?
Fête nationale abandonnée
Sur le papier, aucune loi officielle n'interdisait aux citoyens de commémorer la révolution à leur manière, au-delà des cérémonies officielles, cependant, dans la pratique, les autorités ont cherché à empêcher et, dans plus d'un cas, à punir tous ceux qui assistaient encore à ces événements controversés.
La révolution écrasée de 1956 n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu puisqu'elle a également commencé avec les slogans du 15 mars, le chant des chansons de Kossuth, la commémoration à la statue de Bem et le déploiement des drapeaux nationaux. En plus de cela, le mouvement MUK, déterminé à ressusciter la révolution en mars suivant, a également tenu les autorités sur leurs gardes.
À partir de cette année-là, le régime de Kádár était douloureusement conscient du double sens du 15 mars et était paranoïaque quant à la possibilité d'une autre révolte. Les années 60 ont vu un changement inattendu lorsque la dictature a décidé de changer de stratégie et a reconstitué les célébrations scolaires du 15 mars afin de garder les jeunes sous surveillance, les empêchant d'affluer dans les rues pour protester. Selon tortenelemportal.hu, les enseignants ont activement découragé les élèves de participer à tout événement public commémorant le 15 mars. Ceux qui tentaient encore de manifester leur patriotisme craignaient de graves conséquences.
Mourir pour la liberté ?
Dans les premières années du régime, les autorités n'étaient appelées que pour faire face à des « troubles » mineurs, le nombre de participants n'a jamais dépassé la centaine, et les spécialistes n'ont pas connaissance de représailles policières majeures. Bien qu'il ne corresponde pas dans le temps aux célébrations du 15 mars, il est important de mentionner le cas de Sándor Bauer, en raison de l'emplacement et des symboles utilisés dans l'acte tragique. Le 20 janvier 1969, l'étudiant de 17 ans s'asperge d'essence dans le jardin du Musée national tout en agitant des drapeaux nationaux à deux mains comme une torche vivante pour protester contre l'occupation soviétique et l'oppression du parti-État.
Les citoyens auparavant réduits au silence et opprimés ont commencé à retrouver leur voix dans les années 70. Des centaines de jeunes se sont rassemblés devant la statue de Petőfi à Budapest dans le cadre d'une manifestation illégale le 15 mars 1972, qui a été violemment réprimée par la police d'État. Plus de 90 participants ont été emmenés par les autorités et 15 d'entre eux ont même été placés en garde à vue, pour altercation publique. Dans les années suivantes, le régime décréta une quasi-loi martiale pour la date tant redoutée, et plusieurs unités de la milice ouvrière et de l'armée populaire se dressèrent conjointement contre les manifestants dans les rues de Budapest.
Manifestations sanglantes du 15 mars
Le prochain affrontement sanglant entre les manifestants et la police a eu lieu à l'illustre Pont des Chaînes de la capitale en 1986, mais cette fois, les dirigeants ont anticipé la foule et ont élaboré un plan malveillant. Les gens ont été conduits par la police et des provocateurs en civil vers le pont des chaînes, qui était bloqué aux deux extrémités, puis ont commencé à battre et à frapper les manifestants. L'objectif de la police n'était pas seulement de disperser la foule - ils voulaient donner l'exemple avec la violence brutale et les tirs de masse qui sont entrés dans l'histoire sous le nom de "Bataille de Chain Bridge". Cette terreur policière à grande échelle a également été reprise dans la presse occidentale, les noms de nombreuses jeunes victimes enlevées étant lus sur Radio Free Europe.
La direction confuse a donc été obligée de prendre du recul et d'atténuer la violence. Le 15 mars 1989, la police a fait preuve d'une tolérance inhabituelle envers les manifestants dont le nombre dépassait alors plusieurs centaines. Le Le régime communiste a pris fin la même année et les Hongrois ont finalement pu se souvenir librement des héros de la révolution de 1848 et ont organisé des célébrations dans tout le pays.
Lisez aussi : Événements gratuits passionnants en Hongrie le 15 mars, jour de la fête nationale
La source: tortenelemportal.hu, hvg.hu, ujkor.hu
veuillez faire un don ici
Nouvelles Hot
Que s'est-il passé aujourd'hui en Hongrie ? — 2 mai 2024
Scandaleux : un adolescent arrêté pour avoir planifié une attaque contre une mosquée en Hongrie – VIDEO
Vous pouvez désormais acheter des billets pour des expositions et des visites touristiques sur les plateformes Wizz Air !
La Marche des Vivants aura lieu ce dimanche à Budapest
Imprévu : les travailleurs immigrés hongrois quittent l’Autriche – voici pourquoi
L'OCDE voit l'économie hongroise se renforcer